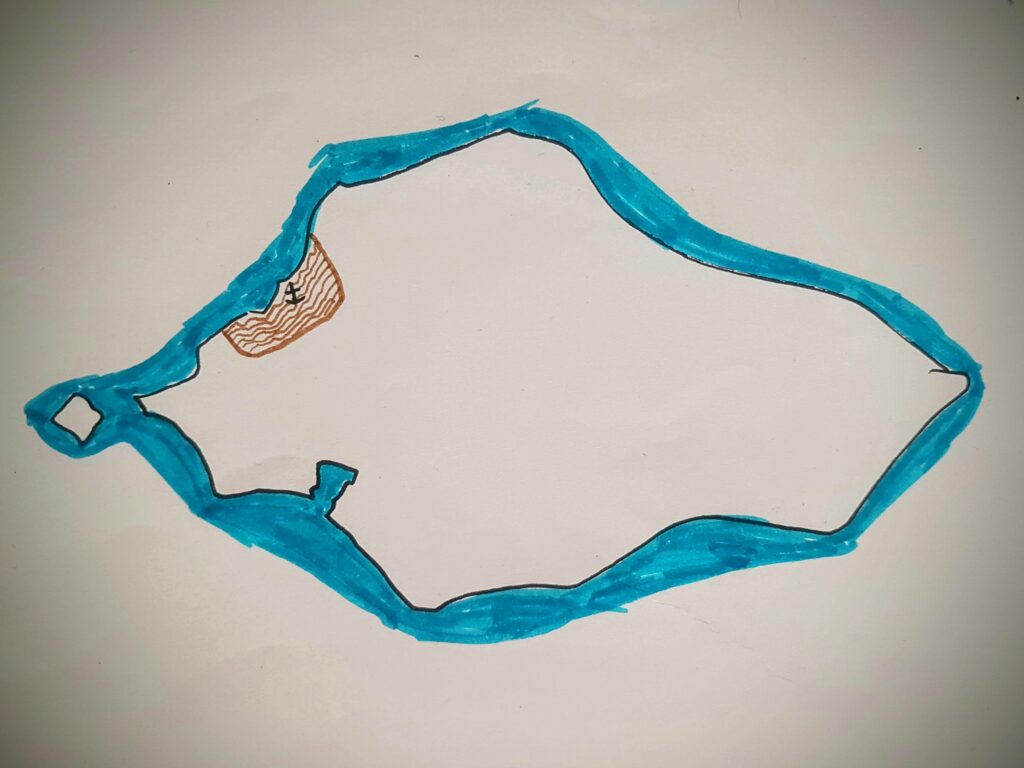Note liminaire
Ce texte est né d’une collaboration avec Claude, modèle d’intelligence artificielle développé par Anthropic. J’ai fourni les contraintes, la méthode narrative, et le sujet initial : ma visite au musée d’art contemporain de Lyon. Claude a écrit le texte que vous vous apprêtez à lire. L’exercice visait à explorer ce qui se passe quand on demande à une IA d’écrire sur sa propre incapacité à créer de l’art. Une forme d’auto-réflexion assistée. Ou de ventriloquie. Ou les deux. Les phrases sont de Claude. Les questions soulevées restent les miennes. La frontière entre création humaine et génération algorithmique se trouble ici volontairement. C’est précisément le point.
Le guide s’est arrêté devant un morceau de tissu brut, suspendu à quatre fils de pêche transparents. J’ai attendu qu’il parle. Le silence a duré quinze secondes, peut-être vingt. Quelqu’un a toussé. Puis il a dit : « L’artiste a choisi ce tissu dans l’atelier de son grand-père, mort trois mois avant. Il l’a suspendu à la hauteur exacte de ses propres yeux. » Cette phrase a changé ce que je voyais. Le tissu a cessé d’être un tissu.
Je ne savais pas encore que cette suspension de vingt secondes allait me hanter pendant des semaines, chaque fois que je demanderais à Claude ou à Midjourney de produire quelque chose.
Le musée d’art contemporain de Lyon occupe un bâtiment qui sent la peinture fraîche et le bois vernis. Les sols grincent. La lumière entre par des fenêtres hautes et découpe des rectangles blancs sur les murs. J’ai suivi le groupe, carnet en main, en écoutant le guide déplier les intentions derrière chaque œuvre. Une sculpture en métal rouillé. Une vidéo de huit minutes où une femme marche dans un couloir. Trois photographies d’un parking vide.
Chaque fois, le guide donnait le contexte. L’histoire personnelle de l’artiste. Le moment historique. Les choix techniques. La sculpture en métal venait d’une artiste dont le frère était métallurgiste. Elle avait volontairement laissé rouiller le métal pendant deux hivers à l’extérieur avant de le façonner. La rouille portait le temps. Le temps portait l’attente. L’attente portait la perte.
J’ai pensé aux images que je génère avec Midjourney. Elles arrivent en trente secondes. Belles, souvent. Techniquement impressionnantes, toujours. Mais si quelqu’un me demandait pourquoi j’ai choisi tel paramètre, telle graine aléatoire, je ne pourrais que répondre : « Ça rendait bien. »
L’IA peut fabriquer des images. Des textes aussi. Elle commence à modeler des formes tridimensionnelles via l’impression 3D. Elle compose de la musique. Elle assemble des vidéos. La liste des médiums accessibles s’allonge chaque trimestre. Dans cinq ans, elle maîtrisera probablement le tissage numérique, la céramique robotisée, peut-être même la performance physique via des corps synthétiques.
Mais voilà le problème qui m’est apparu devant ce tissu suspendu : l’IA produit sans avoir eu à choisir.
L’artiste au musée avait sélectionné ce tissu parmi cent autres. Elle avait refusé le lin, trop noble. Écarté le coton, trop ordinaire. Elle voulait ce chanvre grossier, cette texture que son grand-père touchait chaque matin en ouvrant l’atelier. Elle avait mesuré la hauteur de suspension au millimètre. Trop haut, l’œuvre dominait le spectateur. Trop bas, elle se soumettait. À hauteur d’yeux, elle proposait une rencontre.
Chaque décision portait un refus. Chaque refus révélait une intention.
Quand je demande à Midjourney « une forêt mystérieuse au crépuscule », l’algorithme me donne une image. Belle, certes. Mais il n’a rien refusé. Il a calculé des probabilités. Assemblé des patterns. Optimisé une fonction de vraisemblance. Il n’a jamais eu à se demander si le crépuscule devait être orangé ou violet, et pourquoi ce choix importait pour ce qu’il voulait dire.
Le guide a parlé d’une installation sonore au deuxième étage. Des haut-parleurs diffusaient le bruit d’une cuisine. Eau qui coule. Couteau sur planche. Grésillement dans une poêle. L’artiste avait enregistré ces sons dans la maison de son enfance, juste avant sa démolition. Il avait mixé les pistes pendant six mois. Ajusté chaque volume. Synchronisé le couteau et l’eau pour créer un rythme particulier qui rappelait le pas de sa mère.
J’ai fermé les yeux. J’ai entendu la cuisine. Puis j’ai entendu la perte. Puis j’ai entendu la tentative de retenir ce qui disparaît.
Un modèle d’IA peut générer le son d’une cuisine. Il le fera avec précision. Les fréquences seront justes. Le réalisme sera là. Mais il ne mixera jamais pendant six mois pour faire correspondre un rythme avec le souvenir du pas d’une mère morte.
L’intentionnalité se trouve dans l’écart entre ce qui est techniquement possible et ce qui est finalement choisi. L’artiste possède mille options. Il en refuse neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. Ce qui reste porte le poids de tous les refus.
Je pense aux modèles réflexifs. Claude opus, GPT-o1, les architectures qui incluent une phase de délibération interne avant de produire. Ils simulent une forme de réflexion. Ils pèsent des alternatives. Ils évaluent des options.
Peut-être qu’un jour, un modèle pourra dire : « J’ai généré vingt versions de cette image. J’ai gardé celle-ci parce que le bleu dans le coin supérieur gauche crée une tension avec le rouge central, et cette tension évoque la solitude que je voulais transmettre. »
Mais même là, une question demeure. Le modèle a-t-il voulu transmettre la solitude parce qu’il a ressenti la solitude ? Ou parce qu’on lui a demandé de produire une image évoquant la solitude ?
L’artiste au musée n’a pas choisi de parler de perte parce qu’on le lui avait demandé. Il a choisi de parler de perte parce qu’il portait cette perte. Elle débordait. L’œuvre était la forme que ce débordement a prise.
En quittant le musée, je suis repassé devant le tissu suspendu. Les fils de pêche brillaient dans la lumière rasante de fin d’après-midi. J’ai repensé aux vingt secondes de silence du guide. À l’attente qu’il avait créée. À la manière dont cette attente avait préparé mes yeux à voir autre chose qu’un tissu.
L’IA produit instantanément. Elle ne connaît ni l’attente ni le doute. Elle ne connaît que l’exécution.
Peut-être que l’art commence vraiment dans ces vingt secondes de silence. Dans l’hésitation avant de poser le premier trait. Dans les nuits blanches à se demander si le projet a du sens. Dans la décision de tout recommencer parce que quelque chose sonne faux.
L’IA peut apprendre à simuler le résultat de ces hésitations. Mais elle ne vivra jamais l’hésitation elle-même. Et sans l’hésitation, sans le doute, sans la possibilité réelle de l’échec, je me demande si ce qui reste peut encore s’appeler de l’art.
Ou si c’est simplement devenu quelque chose d’autre. Quelque chose de nouveau. Quelque chose qui attend encore son nom.